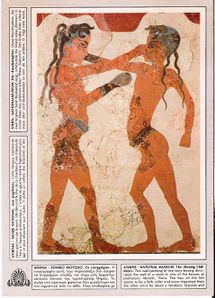Mars 1996
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur les expressions familières impulsée par D.François-Geiger[i] et il succède plus précisément à une approche des emplois familiers de verbes courants du français[ii]. Certains des points dégagés lors de cette approche seront repris pour être approfondis tandis que d'autres ne seront que rappelés et cette présentation ne se prétend pas définitive.
Pour ce qui va suivre, il importe de distinguer, les emplois familiers de termes de l'emploi de termes familiers. Seuls les premiers seront retenus et, particulièrement, en ce qu'ils résultent de processus descriptibles alors que l'emploi de termes familiers ne relève que d'un étiquetage lexical.
Des lexèmes sont en cause dans les deux cas mais entre l'appartenance de certains d'entre eux à des vocabulaires caractérisés (les termes "familiers") et le fait que certains autres voient leurs acceptions varier selon leurs conditions d'emploi, les phénomènes concernés diffèrent considérablement. L'indice "familier" appliqué à des emplois de lexèmes affecte la signification que ces lexèmes acquièrent dans certains de leurs emplois alors que rien de comparable n'intervient pour les termes lexicalement indexés.
Le corpus des expressions employées familièrement sera constitué d'exemples attestés et confirmés, pour la plupart, par leur entrée dans un dictionnaire usuel. J'ai utilisé le Petit Robert[iii]et, pour vérification exceptionnelle, un dictionnaire "spécialisé" en expressions marginales[iv].
Aussi bien dire que le dictionnaire sera utilisé comme un observatoire de faits de langue et de discours, ce qui écarte toute mise en cause de ses procédures internes et exclut d'en exagérer la portée. Le dictionnaire illustre des échantillons et propose des modèles, les créations précèdent son inventaire, la masse des phénomènes langagiers in vivo l'excédera toujours.
Emplois "familiers" et stigmatisation sociale
Les indications fournies pas les dictionnaires sont hétérogènes, comme l'on sait. Celles qui accompagnent les emplois sont, en gros, de deux ordres, les unes linguistico-descriptives (ex.:fig., ellipt., par ext.,), les autres, appréciatives par rapport à une norme d'usage.
Alléguer le caractère subjectif des appréciations justifie, à la rigueur, leur disparité potentielle mais n'explique pas leur teneur, laisse dans l'imprécision ce qu'au juste elles recouvrent.
Lorsque, dans la démarche définitoire qui ouvre son précieux Que sais-je ? sur Le Français populaire, Pierre Guiraud écrit qu'"une expression du type : qu'est-ce que tu fabriques ? est, sinon populaire, en tout cas familière"[v], comment s'effectue le passage d'un qualificatif à l'autre ?
Si même l'auteur qui domine son sujet oscille entre les deux, si les dictionnaires présentent des fluctuations dans leurs appréciations -et sans compter les dissensions que montrerait, vraisemblablement, une enquête auprès des locuteurs-, qu'est-ce qui relie et articule ces appréciations ?
Fixons nous sur les deux termes "familier" et "populaire" employés par Guiraud, pris comme les pôles dont peuvent se rapprocher d'autres notations éventuellement rencontrées dans les dictionnaires, telles que "vulgaire" ou même "courant".
La stigmatisation sociale paraît plus catégorique pour l'adjectif "populaire" que pour "familier". Qu'implique donc un emploi ainsi qualifié ? Qu'entend-on sous le vocable de "familier" ? Quelle position sur l'échelle de l'évaluation sociale des expressions celles qui sont jugées "familières" occupent-elles ?
Le "familier" met en cause la distance interlocutive, distance dont la réduction est collectivement ressentie comme soumise à des restrictions. On entrevoit là un biais par lequel peut s'opérer le glissement entre la familiarité et une dévalorisation sociale.
J'ai, précédemment, été amenée à définir le code de politesse comme "modèle d'organisation symbolique de l'espace social", comme système symbolique d'assignation des places respectivement imparties à je, tu et il pour représenter l'ordre social[vi].
Parler "familier" équivaut à effectuer un rapprochement entre les partenaires de l'échange verbal, rapprochement que la collectivité estime devoir s'accompagner de certaines précautions. Cet avertissement -tacite ou exprimé (ce qu'il est lorsque le dictionnaire en fait état)-, ne présuppose-t-il pas l'existence d'une bonne distance interlocutive ?
Il y a plus ; à propos de la notion de "familier", Freud en dégage des aspects fort éclairants pour ce qui nous occupe dans son essai traduit sous le titre : L'inquiétante étrangeté[vii].
A partir d'une analyse étymologique des antonymes allemands unheimlich et heimlich d'où ressort leur coïncidence sémantique, il établit l'ambivalence du terme qui correspond à celui de "familier" en français. Ce sont les composantes de cette ambivalence que dévoile Freud qui nous intéressent ; elles permettent de comprendre les raisons pour lesquelles il convient de respecter la "bonne" distance interlocutive.
Des contextes qui illustrent les emplois "familiers" de lexèmes
Nous considérerons que les exemples d'emplois familiers de termes fournis par le dictionnaire contiennent les indications suffisantes pour la réutilisation des termes dans le même registre, ce qui suppose une reproductibilité des conditions de leur emploi.
Que les contextes d'emploi proposés varient en fonction de l'appartenance catégorielle des lexèmes concernés coule de source : les noms apparaissent dans des contextes propres aux noms et les verbes dans des contextes propres aux verbes.
Comparons, à titre d'exemples-types : quelle courge !, quelle cruche !, quel navet ! et causer chiffons, mettre des coups, des gnons à quelqu'un, prendre des coups, une raclée.
Par-delà les rôles respectifs des éléments en cause dans la constitution de la phrase, je voudrais saisir ce qui se noue de par le fait que c'est en tant que Noms que les noms deviennent "familiers" et en tant que Verbes que les verbes le font .
Le statut "familier" d'un terme se manifeste par une acception particulière que le terme acquiert de par son emploi. Pour les noms, seule leur confrontation avec les désignés auxquels ils s'appliquent peut justifier la modification de leur sens jusqu'à une acception particulière.
Autrement dit, après avoir chassé du signe linguistique toute trace du référent, s'impose-t-il d'en réintroduire un avatar ? De fait, le désigné auquel s'applique un nom, quel que soit son emploi, appartient lui-même à une certaine classe sémantique de référents et c'est en tant que représentant de cette classe qu'il conférera au nom son sens "propre" ou "familier".
Ainsi est-ce chaque fois que les noms courge ou cruche désigneront une personne, que navet désignera un film, etc... que le sens propre de ces noms s'effacera au bénéfice de leur sens familier. La systématicité du déplacement d'une classe sémantique de référents à une autre permet le réemploi des expressions familières à partir des exemples cités par le dictionnaire. De cette manière se crée la polysémie d'une forme nominale selon la classe des référents à laquelle renvoie la forme lorsqu'elle est mise en énoncé.
Dans le cas des verbes, la polysémie n'est pas produite par le même processus ; ce sont leurs compléments qui modifient le sens propre des verbes jusqu'à leur acception familière. Mettre en arrive à signifier donner, prendre équivaut à recevoir avec des compléments comme "des coups" , "des réprimandes" ou termes approchants.
Pour servir à ses utilisateurs, le dictionnaire ne peut manquer de mentionner ou, au moins, suggérer le type de compléments responsables de l'acception familière des verbes.
Une problématique des "emplois familiers" de lexèmes
Convenons d'appeler "déclassement" de lexèmes l'aboutissement de processus par lesquels des lexèmes figurant au dictionnaire sans mention particulière, voient une ou plusieurs de leurs acceptions indexées "familières" (voire "populaires"). Le terme est donc à rapporter à la norme sociale de registres de langue.
Parvenir à établir, après l'examen des types de contextes qui illustrent le déclassement lexématique, que les Noms et les Verbes se déclassent au sein de leurs respectives classes grammaticales d'appartenance, voilà une conclusion d'une circularité évidente. Sommes-nous condamnés à ne trouver à l'arrivée que ce que nous savions au départ avec la sensation de ne pas avoir avancé d'un pouce?
Dans le constat du fait que le déclassement des lexèmes tombe sous la domination de l'opposition verbo-nominale du français, d'aucuns peuvent estimer qu'il n'y a que du connu sans conséquences, ce qui prouve que ma réflexion est plus laborieuse que la leur. Si ce que recouvre ce constat est si banal, par quelle négligence, impardonnable, de lecture aurais-je manqué la rencontre de son explication claire et convaincante ?
Car, sous l'évidence se dissimule un entremêlement de facteurs d'ordres logico-sémantique, grammatical et pragmatique susceptible de légitimer une diversité d'approches du phénomène "langage familier".
En premier lieu, il importe de concevoir les catégories grammaticales à l'intérieur desquelles s'effectue le déclassement des lexèmes comme résultant de la grammaticalisation, spécifique à nos langues, de catégories référentielles. Enoncer que les noms se déclassent en tant que Noms et les verbes en tant que Verbes cesse alors d'être tautologique par l'identification, sous nos catégories grammaticales, de catégories référentielles de portée universelle.
Que de l'observation des contextes proposés en exemples de déclassement lexématique émergent deux types différents de processus, l'un caractéristique de la catégorie des Noms et l'autre correspondant à celle des Verbes, ces catégories sont à comprendre comme représentatives de l'organisation grammaticale de deux modes de référence. Aux Noms est impartie la capacité intrinsèque de référer aux objets du monde tandis qu'est laissée aux Verbes celle de référer dans le cadre de la proposition[viii].
Se trouve, de la sorte, circonscrit le lieu de croisement entre modes de référence et catégorisation grammaticale, ce qui situe le déclassement lexématique à la jonction du pragmatique et du linguistique. Cependant, cet éclaicissement aide-t-il à déterminer ce qui, en matière d'acceptions familières, ressortit respectivement au pragmatique et au sémantique ?
Dans quelle mesure le code de la langue est-il affecté par la polysémie que crée les emplois familiers des lexèmes ? Quel rôle jouent les significations "subsidiaires" dans la dynamique de la langue ? Un seul exemple fera comprendre que ce rôle est loin d'être négligeable : à partir du lexème mufle avec son sens propre, se forme un sens figuré et familier sur lequel se greffe un dérivé muflerie qui, lui, ne porte plus les stigmates de son origine familière.
L'acception familière d'un lexème est-elle en relation avec son sens propre et, dans l'affirmative, de quel type est cette relation ? La notion de "signifié" des lexèmes reste-t-elle valide dans un tel cadre ?
Il apparaît d'autant plus illusoire de prétendre répondre, ici, à l'ensemble de ces questions que la dimension diachronique ne sera pas traitée mais le poser permet de cerner une problématique des emplois familiers ouverte sur certains aspects relativement peu explorés du phénomène.
Je ne m'attacherai ici qu'à l'un d'entre eux, délaissant provisoirement tout ce qui a trait aux emplois familiers dans la constitution de la phrase, intonation comprise et ce, malgré son rôle prépondérant.
Du processus de "déclassement" des lexèmes nominaux
Reprenons au point clé suivant lequel les noms se trouvent déclassés de par l'inadéquation de la classe sémantique des référents à laquelle ils s'appliquent par rapport à celle des référents qu'ils dénomment en propre tandis que pour les verbes, c'est par les compléments qui leur sont affectés que leur acception devient familière.
Attachons nous à décrire ce qui se passe lors du décalage dénominatif d'une classe sémantique à une autre par l'emploi d'un nom pour un référent inapproprié.
Soit les lexèmes : poire, nouille, cruche, boudin, andouille etc...; ils acquièrent tous une acception particulière dès lors qu'ils s'appliquent à des personnes, pastis prend son sens familier lorsqu'il est appliqué à une situation, navet prend le sien lorsqu'il est appliqué à un film etc...
Pour les formes nominales, c'est le fait d'être appliquées à d'autres objets qu'à ceux auxquels l'ordre de la langue les destine qui crée leur redoublement sémantique. Au sens propre assigné à une forme nominale s'en superpose un autre que révèle un désigné étranger à la classe des référents dénotés et qui n'efface ni n'altère le sens propre. On doit dépasser le modèle saussurien du signe pour dégager le mécanisme de superposition sémantique à l'œuvre lors de l'emploi familier des lexèmes.
A quelle opération se livre un locuteur qui emploie, par exemple, le lexème andouille à l'endroit d'une personne ? Quelle que soit la construction syntaxique dans laquelle entre le lexème, se trouve posée l'équation : x ETRE y qui met andouille en position d'attribut par rapport à la personne désignée et c'est le premier point.
L'attribut est censé représenter la caractéristique essentielle de x , en d'autres termes, le sens propre du lexème andouille devient qualité consubstantielle du désigné.
On pourrait dire aussi que, selon la logique classique, on passe d'une définition en extension d'un concept à sa compréhension, laquelle embrasse théoriquement, l'ensemble des caractéristiques qui détermine le concept[ix]. Ramené à notre cas, cela revient à poser que le sens propre du lexème employé par le locuteur contient l'ensemble des propriétés qui sera attribué au référent désigné (à la personne, en l'occurrence).
C'est ce même principe qui est à la base de tous les emplois familiers de lexèmes nominaux.
En décomposant en sens 1 et 2 pour une forme nominale, son sens 1 est propre à un certain concept et son sens 2 englobe les caractéristiques inhérentes à ce concept pour les attribuer à l'objet désigné. Le sens 2 d'une forme nominale est donc à considérer comme résumant l'essentiel des qualités propres au concept dénoté par le sens 1 du lexème et ce sont ces qualités qui définiront le référent désigné.
L'acception familière d'un lexème nominal résulte donc de l'attribution à un certain référent de propriétés censées caractériser l'objet dénoté par le sens propre du lexème.
Regardons les exemples mentionnés précédemment : dès que des lexèmes comme poire, andouille, courge, cruche ou tout autre de la même veine, s'appliquent à des personnes, sont attribués à celles-ci des traits censés définir ces différents "objets".
Se comprend de la sorte aisément l'absence de spécificité sémantique qui caractérise les acceptions familières des lexèmes. Au terme d'un processus d'attribution tel que nous le révèle le fonctionnement des expressions familières, quelles particularités sémantiques d'un lexème se retrouvent-elles dans le référent visé par son emploi ? Certes, restent les éventuels traits communs qui fondent les sens "figurés" : entre le concept dénoté par le lexème nouille et "une personne molle et niaise", selon le dictionnaire, une ressemblance de "consistance" peut être alléguée, de même que le dictionnaire, toujours, relève l'"idée de mélange" comme lien entre la boisson d'origine marseillaise pastis et une situation embrouillée ou encore la fadeur de la racine appelée navet et l'ennui distillé par un film.
Il serait absurde de nier ces rappels sémantiques mais on voit surtout nettement par quelle sorte de filtre passe le sens d'un lexème pour aboutir à une acception familière du même lexème. Pour ne prendre que l'exemple de navet, l'insipidité constitue-t-elle la propriété la plus spécifique de la plante ? Un botaniste s'en accommoderait-il ?... La déperdition sémantique qui caractérise le passage du sens propre au sens familier d'un lexème se produit très exactement au moment et à l'endroit de l'attribution, lorsque, dans notre exemple, d'un ensemble de traits descriptifs du végétal un seul est (arbitrairement ?) extrait et attribué à un désigné.
Pour aussi manifestes qu'apparaissent les emplois figurés, ils n'en restent pas moins secondaires en regard de la relation qui unit le sens 1 au sens 2 d'un lexème nominal par une attribution via un référent désigné. Qu'existe la possibilité effective de transférer sur un objet désigné certains des traits propres aux objets dénotés par le sens 1 d'un lexème facilite le déclenchement du mécanisme attributif mais n'en fait pas pour autant une condition indispensable à son fonctionnement. En revanche, l'incompatibilité des classes sémantiques auxquelles appartiennent respectivement les dénotés et les désignés est, à mon avis, beaucoup plus probante.
Illustrons ces points : les cas foisonnent de lexèmes dont l'acception familière se déduit d'une certaine analogie entre le dénoté et le désigné, ainsi pour pomme et la figure, marron ou châtaigne et le coup de poing, portugaise (l'huitre) et l'oreille etc... mais, déjà, entre le dénoté par le lexème tarte et ses potentialités sémantiques d'acception "populaire" lorsque la forme signifie "coup, gifle" ou "familière" lorsqu'elle équivaut à "laid, sot et ridicule, peu dégourdi", invoquer une quelconque analogie relève plus de la fantaisie que de l'argument sérieux.
Ce qui se produit, par contre, et qui est amplement exploité par les locuteurs, c'est le croisement de classes sémantiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Bien entendu, la mise en énoncé activera telle ou telle acception du lexème : tarte désignant un coup servira de complément à certains verbes (tels que mettre, flanquer, prendre, éventuellement donner...) tandis que la même forme appliquée à une personne -et fréquemment en emploi prédicatif- n'a rien de flatteur pour la personne et c'est l'aspect sur lequel j'insisterai.
Indépendamment de toute similitude imaginable entre une pâtisserie et une personne -aussi sotte soit-elle-, l'effet familier est dû, précisément, à l'attribution faite à la personne de caractères propres à ... une pâtisserie. Le recours, quasi systématique, à des dénotés appartenant aux classes sémantiques couvrant les champs du comestible, de l'animal, de la maladie, des ustensiles domestiques ou objets utilitaires, pour en attribuer des propriétés à des humains reste un des moyens privilégiés de création d'expressions familières.
J'ai mentionné plus haut que la figuration des emplois était plus accessoire qu'il n'y paraissait, que la prise d'appui sur d'éventuels traits du dénoté pour qualifier un désigné n'était pas capitale pour asseoir une acception familière ; j'irai plus loin encore.
Dans la mesure où le mécanisme d'attribution est acquis, intériorisé par le locuteur, dans son esprit une relation s'établit automatiquement entre le sens 1 d'un lexème et son ou ses sens 2 potentiels. Puisqu'il sait qu'une telle relation existe et comment elle se constitue, peut-on, honnêtement, affirmer qu'il ne sera jamais amené à la justifier après coup ? Lorsque deux éléments quelconques sont donnés comme liés, n'est-ce pas un besoin de la rationalité humaine que de fonder leur rapport, le motiver, chercher une base commune aux deux éléments concernés ? Qu'une telle base vienne à manquer et ce, à cause de la disparité des classes à laquelle chacun des éléments appartient, ne peut s'ensuivre qu'un effet de dislocation de la rationalité, un défi à la raison.
Quelle preuve fournir de ce que la fadeur est bien à l'origine de l'emploi détourné du lexème navet ? Dans la masse des attributions que le langage permet d'effectuer, certaines s'étayent probablement sur des traits repérables et d'autres pas. Pour ce cas, seul l'usage consacre l'acception familière, bien entendu mais surtout, l'écart entre les classes sémantiques d'appartenance du dénoté et du désigné signale le changement de registre du vocabulaire. Qu'un étranger ne saisisse pas immédiatement le rapport possible entre un navet et un mauvais film, s'il connaît le sens propre du terme et comprend à quelle réalité il est appliqué dans un certain énoncé, il saura qu'il a forcément affaire à un emploi déclassé du terme de par l'incongruité même du rapprochement effectué.
Il est plausible que, dans la durée, les acceptions fondées sur quelque écho sémantique entre le dénoté et le désigné se révèlent plus stables que celles qui ne dépendent que de modes passagères. Les emplois des lexèmes cageot ou boudin rendus familiers lorsqu'ils sont appliqués à des personnes (de sexe féminin) bien qu'attestés, ne sont pas encore consignés en tant qu'acceptions particulières dans le dictionnaire que j'ai utilisé. Le seront-ils un jour ? Dans cette éventualité, l'extraction de quelque trait de similitude ne servirait-elle pas à "expliquer" leur installation dans le lexique ? En admettant que, pour boudin au moins, cette extraction livre un résultat acceptable, que dire de cageot s'il venait à perdurer dans son emploi déclassé ?... On est là dans une zone de mouvance extrême, d'utilisation marginale et ludique de la langue, de création d'effets sans cesse renouvelés, par nécessité, puisqu'ils s'émoussent proportionnellement à leur fréquence d'usage.
Ce qui demeure intact, en revanche, c'est le procédé qui produit ces effets, le recours à l'attribution pour mettre à parité des classes sémantiquement inconciliables.
Du processus de "déclassement" des lexèmes verbaux
Avec le traitement des verbes, nous rejoignons le terrain du proprement linguistique, plus précisément celui du sémantico-syntaxique.
D'un précédent travail sur le mode de déclassement des verbes il ressortait que ce déclassement était imputable aux compléments, ce qui n'a rien de novateur[x]. Je ne ferai, ici, que raffiner l'analyse en traitant séparément les différents types de compléments ce qui permettra de nuancer quelque peu la conclusion première.
A) Les compléments nominaux :
En partant du principe que ce sont les compléments qui causent le changement sémantique des verbes de leur sens propre à leur acception familière, il est remarquable que ces compléments continuent de jouer leur rôle alors qu'ils peuvent rester totalement ou partiellement inexprimés dans les énoncés. Comparons les expressions suivantes telles qu'elles figurent au dictionnaire : Je vais t'allonger une gifle ; La boucler ( = se taire) et Qu'est-ce qu'il lui met ! ou Qu'est-ce qu'il a pris !
Dans le premier exemple, le complément a sa forme pleine, dans le second il est sous-entendu mais représenté par un pronom et, enfin, totalement absent du troisième exemple.
Les emplois "absolus" de verbes dans leur sens familier sont d'autant moins rares que les compléments rétablis par la collectivité parlante présentent une coloration sémantique commune ; ils couvrent invariablement le champ de la violence, de l'hostilité, du mauvais vouloir.
Ainsi mettre en arrive-t-il à signifier donner, prendre à signifier recevoir avec pour compléments : des coups, une correction physique ou verbale, que ces compléments soient exprimés ou pas mais, surtout, à l'exclusion de tout autre qui convoquerait une notion agréable.
De même, les acceptions familière de verbes comme fabriquer, chanter, raconter... en emploi absolu et, notamment, dans des énoncés interro-exclamatifs ne peuvent-ils évoquer que des compléments dont le sémantisme renvoie au dérisoire, au faux, à l'indigne de foi ou de considération.
Le point important est que la déviation sémantique des verbes repose davantage sur la tonalité dépréciative générale de leurs compléments que sur le contenu précis de ceux que l'on pourrait accoler, respectivement, à chacun de ces verbes.
Dans ces conditions, une question se pose, impossible à éluder : doit-on continuer à soutenir qu'un verbe change de sens sous l'influence de ses compléments lorsque ces compléments ont pour caractéristique d'être effaçables formellement et dissous sémantiquement ? Ne se présente-t-il pas de cas de verbes dont le sémantisme se dévie et qui accorderaient, secondairement, leurs éventuels compléments avec cette déviation ?
Le degré d'interdépendance des deux processus est à proportion de celui qui lie un verbe à ses compléments et si l'on maintient que le sémantisme d'un verbe est fonction des compléments qui l'accompagnent, on devrait s'attendre à ce que les verbes réputés intransitifs soient à l'abri de toute dérive sémantique et, en particulier, de tout déclassement familier. Qu'en est-il ?
Il est vrai que, lors de ma collecte, j'ai rencontré peu de verbes proprement intransitifs auxquels des sens 2 soient aussi univoquement attribuables qu'à mettre ou prendre. Il est, cependant, au moins un contre-exemple : celui de marcher. Employé familièrement, son sens va d'"acquiescer, donner son adhésion (à quelque chose)" à "croire naïvement quelque histoire" et est signalée aussi l'expression "Marcher dans la combine". Hors de l'expression figée qui, comme toute autre, a sens global et en admettant que, même défigée, elle continue d'imprimer son influence sur l'acception qu'y acquiert le verbe, quel complément incriminer dans le déclassement de celui-ci ? Face à l'impossibilité d'en préciser aucun, comment décrire ce déclassement ?
Aurait-on affaire à un mécanisme comparable à celui qui est à l'œuvre pour les noms avec le croisement de classes sémantiques disparates ? La figuration sémantique par transposition du physique au moral équivaudrait-elle à un enjambement de classes sémantiques séparées, entraînant un changement de registre des lexèmes transposés ? La langue semble bien encourager une telle lecture si on en juge par le nombre d'exemples tels que tenir (le coup), clouer (le bec), boucler (quelqu'un), gratter (quelque chose), fumer (être en colère) etc... à ceci près que la transposition est loin d'être l'apanage des tournures familières et que le changement de registre des lexèmes dépend de bien d'autres facteurs -dont les compléments verbaux au premier chef- !
Pour marcher, en l'absence de compléments, force est de reconnaître que seule la transposition sémantique provoque le déclassement du lexème. Le champ d'emploi de ce verbe en justifierait une analyse fine, incluant la diachronie car, que marcher signifie aussi fonctionner pour des sujets mécaniques n'est, probablement, pas indifférent pour notre propos.
Néanmoins, en nous en tenant aux acceptions familières et en poursuivant le parallélisme avec le déclassement des noms, pouvons-nous suivre le processus de figuration de manière à préciser la nature des relations entre les sens 1 et 2 des lexèmes, en l'occurrence pour ce qui concerne le verbe marcher ?
Deux solutions s'offrent à nous : soit l'on conçoit qu'entre l'action de marcher et l'obtention d'un consentement le passage s'effectue dans le droit fil de la pensée, soit en refusant de reconnaître le moindre lien entre les deux concepts en sera-t-on réduit à invoquer l'usage avec ce qu'il aurait de motivations externes, voire de gratuit. Dans la première des hypothèses, celle où le sens figuré découle du sens propre, le doublement sémantique indique que nous accepterions comme allant de soi que l'adhésion ne s'enlevât qu'au terme d'un cheminement, au moins pour ce qui est de l'adhésion à une cause douteuse. Quels enseignements sur nous-mêmes ne saurions-nous tirer de l'analyse de nos pratiques langagières !...
Sans laisser l'arbre nous cacher la forêt, d'autant plus que j'ai glissé à un niveau différent de considération des faits en amorçant l'analyse sémantique d'un lexème alors que je m'en tenais, jusqu'à présent, aux mécanismes généraux du déclassement lexématique, que convient-il de conclure en tenant compte de l'exemple de marcher ? Cet exemple infirme-t-il le principe selon lequel le sémantisme d'un verbe dépend de ses compléments ? Serait-on amené à poser que pour mettre et prendre, par exemple, nous aurions respectivement des sens 2 différents des sens 1 tandis que pour marcher, il s'agirait d'un même sens simplement dévié par transposition ? L'argument paraît assez fallacieux, surtout que si on décompose les mouvements indiqués, respectivement, par mettre et prendre, les sens résultant de leur déclassement (soit : donner et recevoir) s'inscrivent, comme pour marcher, dans une direction unique par rapport à leur sens premier.
Une fois écartées les objections possibles, résumons l'essentiel de ce que dictent les faits concernant les rapports entre verbes et compléments.
La complémentation verbale est un facteur d'organisation syntaxique si constant qu'il semble bien que le locuteur en exploite toutes les latitudes dans ses usages ludiques et marginaux de la langue. Que le sémantisme d'un verbe se déforme sous l'effet de ses compléments n'interdit pas, qu'en retour, certaines potentialités sémantiques d'un verbe n'attirent des compléments adaptés.
Une fois qu'on a compris que le sens dit "familier" d'un verbe aboutit, systématiquement, au déni de quelque positivité que ce soit de l'action indiquée par son sens propre et ce, via des compléments renvoyant, sans exception, à du désapprouvé par la morale sociale (violence, agressivité, ruse, sournoiserie, vilénies de toutes sortes), le mécanisme est démonté. Qu'en énoncé et pour un verbe entendu familièrement, le complément ne soit que suggéré ou vienne à manquer entrave d'autant moins la communication que le propre des tournures familières reste de baigner dans le flou, quitte à le créer.
B) Les compléments pronominaux
J'entends par ce qualificatif, les pronoms "personnels" et ne m'occuperai que de ceux de l'interlocution parce que ce sont ceux qui font apparaître des asymétries intéressant les expressions familières. La première particularité de ces pronoms est de désigner des humains -ou traités comme tels-, bien entendu, mais aussi de favoriser les emplois déclassés des lexèmes.
La facilité avec laquelle on utilise des verbes à la voix pronominale en leur imprimant sens familier ne cesse d'interpeller des linguistes. Les emplois "réfléchis" sont, en la matière, des plus productifs mais, sans exclure l'éventualité d'en trouver dont le sémantisme est identique à celui des emplois pronominaux non réfléchis (soit : je me + verbe ou tu te + verbe avec même sémantisme verbal que pour je te + verbe ou tu me + verbe), n'en ayant pas rencontré d'indiscutables, j'insisterai sur ceux qui font apparaître une asymétrie patente entre les deux constructions pronominales.
Nombre de verbes présentent leur sens propre en emploi non réfléchi et leur sens familier exclusivement en emploi réfléchi. Que les exemples en deviennent rebattus à être trop cités ne diminue pas leur intérêt ; il s'agit de se barrer, se tirer, se casser, se trotter, s'éclater, se défoncer, se planter, se fendre, se taper (quelque chose), s'enfiler (quelque chose), s'appuyer (quelque chose) etc... et leurs acceptions déclassées (telles qu'elles s'entendent autour de moi) ne figurent pas toutes dans mon dictionnaire. C'est le cas pour défoncer qui servira, néanmoins, à illustrer l'essentiel de ce qui s'observe.
A je me défonce on peut admettre que correspond l'idée de dépassement de mes limites -par l'effort ou sous l'effet de la drogue, peu importe- et à je te défonce, celle d'une agression physique. Un des sens , noté "courant", du verbe est "briser, abîmer par enfoncement". La première question qui se pose est celle de savoir si la transposition d'un complément direct non humain à un humain familiarise cet emploi ou si on considère que le verbe y garde son sens propre, sans plus. Il n'est pas si rare qu'une telle transposition déclasse les verbes, exemples : dérouiller, allumer, sonner (dans le sens d'"assommer"), raccourcir (dans celui de "décapiter")[xi]... et l'on retrouverait alors un procédé déjà rencontré pour les noms ; à l'"attribué à" -humain vs non humain- du nom répondrait le "complémenté par" pour le verbe.
La deuxième question porte sur l'écart sémantique entre les deux emplois selon que nous ayons coréférence ou non coréférence. Là encore, il ne s'agit pas d'un fait isolé mais d'une régularité qui autorise généralisation. Comparons des expressions de même registre de manière à faire ressortir la tendance qu'elles manifestent :
-je m'en mets plein la lampe / je t'en mets plein la vue
-je m'en balance / je t'en balance des vertes et des pas mûres
-je me fiche par terre / je te fiche une gifle
-je me tape deux pastis / je te tape cent balles
-je me dérouille les jambes / je te dérouille la figure ou je te dérouille.
Entre la fonction objet et la fonction dative du pronom complément, le jeu est tel que l'une ou l'autre l'emporte selon le verbe concerné mais, invariablement, au bénéfice du sujet syntaxique et au détriment de l'autre du dialogue. C'est déjà la conclusion à laquelle m'avait amenée l'examen des tournures pronominales non familières[xii] et la dimension qui se rajoute ici est, au mieux, la dépréciation de l'autre quand il n'est pas la cible de la violence du sujet car c'est bien cela qui est en cause dans les emplois caractérisés comme "familiers".
L'interprétation des phénomènes à la lumière de la conception freudiennne
Freud forge le concept théorique d'"inquiétante étrangeté" et établit ses relations avec le familier essentiellement à partir d'œuvres littéraires. S'il n'est pas surprenant de retrouver dans les cas linguistiques examinés la quasi totalité des facteurs que Freud identifie pour fonder l'analogie entre le unheimlich et le heimlich, le repérage de ces facteurs et de leur jeu apporte à nos analyses une dimension qui peut valoir explication.
Que, par exemple, le déclassement des verbes affecte toujours négativement leur sémantisme, sauf en emploi réfléchi, n'a-il pas de quoi nous mettre sur la voie de la vraie nature des causes du phénomène ? Le recours à des notions mises à jour par la psychanalyse ne vise que la compréhension d'un fonctionnement que les locuteurs doivent, d'une certaine manière, maîtriser puisqu'ils en usent communément sans se tromper.
Il est de fait qu'aucun emploi familier des verbes que j'ai recensés n'échappe à la dévalorisation du procès dès lors qu'il est engagé par un autre humain que par le sujet syntaxique. Que seul ce sujet sorte indemne de la péjoration suffirait déjà pour indiquer dans quelle direction opère le principe à la base de tels emplois. Si qu'est-ce que je t'ai mis ! n'évoque que des compléments directs peu agréables , il en va différemment avec qu'est-ce que je me suis mis ! mais il y a plus encore.
En prenant garde de différencier autant d'"objets" que la polysémie du terme y oblige -même en se cantonnant à la discipline-, on s'aperçoit que c'est toujours l'objet qui subit la disgrâce, l'opprobre ou le ridicule exprimés par emploi familier des lexèmes nominaux. C'est l'objet qui porte la responsablilité de tous les dévoiements du sens des lexèmes verbaux et qui actionne le ressort de leurs faces sémantiques.
Dans le cadre de l'interlocution -celui de l'intersubjectivité tel que Lacan l'a structuré-, face au je du sujet se tient un tu objet (l'autre lacanien[xiii]) avec, comme conséquence qu'à je me fends la pêche répond un je te fends la pêche et que n'importe quel exemple d'asymétrie sémantique illustrera une distorsion pareillement orientée.
Pour le déclassement des verbes avec compléments nominaux, on a vu l'importance des objets syntaxiques . Ce sont des objets qui, sémantiquement, forment ensemble un monde d'une rare inhospitalité à l'égard d'autrui mais si commun à nos imaginaires que nous sommes, en tant que collectivité -et, peut-être, universellement-, censés y rapporter des composantes analogues. Car ces objets n'ont même pas besoin d'être exprimés pour tenir leur rôle syntaxique. Objets escamotés, évoqués par sous-entendus, présents implicitement, dits sans paroles, ce sont eux qui tirent le verbe par le bas et sont responsables de sa chute de registre pendant que le sujet, lui, semble n'intervenir en rien dans ces transformations.
Enfin, lors du déclassement des noms par processus d'attribution, c'est encore à l'objet désigné qu'échoit l'attribut inapproprié. S'opère à cet endroit une telle superposition de niveaux auxquels de respectives notions d'objets appartiennent qu'il devient même difficile d'en parler.
Soit un énoncé du type : quelle courge ! Le référent désigné, qui coïncide avec l'objet du discours, se trouve, en plus, réifié par le fait que lui soit attribué les caractéristiques de la plante dénommée. Tous les emplois de noms rendus familiers par attribution impropre tendent vers un seul but et aboutissent à un résultat unique : le ravalement de l'objet du discours à l'état de chose ou d'animal.
D'une telle insistance, d'une telle accumulation de traits d'objet sur un même élément, il ne reste qu'à tirer confirmation du statut privilégié du sujet. L'observation des données montre qu'un tel "sujet" recouvre la notion d'énonciateur et déborde sur celle de sujet syntaxique. En marge de l'appareil énonciatif, j'en appellerai au sujet parlant, concept linguistiquement insatisfaisant mais dont l'élasticité et le degré de généralité conviennent au rapprochement entre faits langagiers et faits psychiques.
De l'essai de Freud, il ressort qu'au creux du sentiment d'inquiétante étrangeté se love le familier d'antan, d'un temps dépassé de l'évolution psychique. Dans l'usage familier qui est fait de la langue, le privilège dont jouit le sujet se traduit par une expression débridée de son narcissisme. Si l'on se refuse à entendre qu'entre je me crève et je te crève la différence ressortit à un ordre qui dépasse le strictement linguistique, on restera incapable de comprendre comment les locuteurs se repèrent dans l'imbroglio sémantico-syntaxique des emplois pronominaux des verbes.
Le narcissisme ne se manifeste pas que dans les emplois familiers de la langue, il intervient avec régularité dans les constructions pronominales non familières des verbes mais, sous couvert de familiarité, son rôle est considérablement accru ; les exemples familiers d'asymétrie sémantique sont beaucoup plus nombreux que ceux du registre soutenu de la langue et, surtout, le modèle s'en montre extrêmement productif.
Comment ne pas voir la résurgence du même narcissisme dans la réification de l'objet du discours à laquelle se prête le sujet parlant pour déclasser les noms désignant des personnes ? Quelle preuve plus flagrante de l'affirmation du moi et de son pouvoir que de réduire l'autre à l'état de chose pour mieux se l'approprier ? Il n'est pas jusqu'à l'animisme qu'évoque Freud dont on ne puisse relever des traces dans nos tournures mais je ne m'y arrêterai pas et me contenterai de préciser que, lorsqu'au lieu d'une personne le désigné est une situation, une manifestation, une épreuve (exemples : navet pour un film, coton pour un problème, galère[xiv] pour une une difficulté etc...), ces noms recouvrent des appréciations et, surtout, des états du locuteur.
Un autre point exige précision : s'il est apparu que, pour les verbes, toutes les acceptions familières se ramenaient à une péjoration, un déni, un détournement négatif de l'action, se rencontrent, en revanche, pour les noms des acceptions familières valorisantes. Seulement, entendre traiter une fille, par exemple, de canon ou de camion, pour autant d'admiration qu'en soit chargée l'expression, n'en rabaisse pas moins la cible de l'"hommage" au rang d'objet (et quel choix d'objets !...).
Venons-en à l'examen d'un autre facteur aux effets non moins considérables, pour nous linguistes, que ceux du narcissisme du locuteur.
Les sens familiers doublent les sens propres des lexèmes : sous calmer perce la menace ("Attends un peu, je vais te calmer !" note le Robert avec l'indice "familier"), sous sentir, sa forme négative ne pas pouvoir sentir quelqu'un, sous l'andouille charcutière, la pauvre andouille "populaire" attend son tour d'être actualisée.
Le motif du double fait, selon Freud, partie intégrante de ce qui crée l'impression de l'anciennement connu ; une des principales fonctions dévolues au rejeton familier de la langue est de fournir des doubles aux lexèmes.
Le procédé du doublement sémantique des lexèmes est si constitutif de la langue, stratifiée en registres, que son utilisation en arrive à passer inaperçue. Ce doublement ne marquerait-il pas l'origine de la polysémie lexicale, au moins pour ce qui est de l'acquisition de son maniement ? Lorsque l'enfant s'entend dire : viens prendre ton bain, prends ma main et si tu continues de pleurer, tu vas prendre une gifle, il faut bien qu'il enregistre que prendre n'a pas qu'un sens !
Ainsi l'indissociabilité du "tu dois" et "tu ne dois pas" s'inculque-t-elle déjà par la seule duplicité des mots. Mais le plus remarquable de la duplicité sémantique des lexèmes est que la face familière que révèle chacun d'entre eux se présente toujours, par rapport au sens "propre", comme sa face noire, négative, vilainement déformée, jamais souriante, hormis pour ce qui touche au moi ; je crois avoir suffisamment souligné cette constante.
Je finirai par ce qui confère sa caractéristique dominante à l'usage familier de la langue et dont la participation à l'étrangement inquiétant n'a pas échappé à Freud : l'"incertitude intellectuelle" dont il parle trouve sa parfaite illustration dans l'imprécision qui enveloppe les expressions familières. Quand je me tape quelque chose, cela va d'une corvée à une gâterie, si je qualifie ma voisine de tarte, cela en dit juste assez long sur elle, d'autant que je peux aussi lui en filer une...moyennant le même vocable, à moins que je ne lui file rendez-vous, etc...
Le vague, le flou, les contours incertains, l'à-peu-près, le sous-entendu, l'éludé, l'ambigu, voilà les traits qui signalent le plus sûrement les expressions familières et ce, jusqu'à former entre elles un tissu indistinct. Car ces expressions ont, de par leur manque de spécificité, tendance à se rejoindre, à se regrouper autour de ce que j'ai appelé ailleurs un "squelette sémantique"[xv]. Il n'est qu'à compter le nombre de "synonymes" qui traduisent, familièrement, la notion de fuite pour prendre la mesure du phénomène ; je n'y insisterai pas davantage.
A la recherche de ce qui suscite le sentiment d'inquiétante étrangeté, Freud découvre que c'est le retour à "l'antiquement familier d'autrefois", réminiscence de "la terre natale du petit d'homme, du lieu dans lequel chacun a séjourné une fois et d'abord."
A la recherche de principes communs aux emplois linguistiques dépréciés, j'ai vu, avec surprise, émerger le versant sombre de la langue. L'acception familière d'un verbe résulte de la torsion de son sens, celle d'un nom, d'une subversion particulière de l'ordre de la langue. Combien paraît anodine la révolte de Heumpty Deumpty qui, prétendant régner sur le monde, substitue son caprice à la convention dénominative[xvi] ! Le détournement familier des formes linguistiques opère tellement plus souterrainement, jusqu'à l'affleurement des couches archaïques recouvertes par la socialisation.
Chaque verbe porte son négatif, dissimule son revers obscur lequel se découvre en usage familier pourvu qu'autrui soit engagé dans l'action. Par chaque utilisation familière d'un nom s'affirme le désir de possession de l'autre, d'abord réduit au rang de chose, à moins que le sujet ne monopolise l'intérêt sur ses états ou ses opinions propres.
Des expressions figées, on ne trouve que mention dans cet exposé malgré l'importance de la place qu'elles occupent dans le registre du familier. Un travail qui leur a été consacré met en évidence l'apparentement des mécanismes qui président à leur formation avec ceux qui commandent aux rêves[xvii]. Manifestations langagières qui remontent aux sources infantiles, locutions figées et expressions familières comme résurgences d'une époque lointaine, jamais effacée, voilà qui éclaire d'un jour inattendu l'usage qui en est fait !
L'intervention de la Norme qui stigmatise l'apparition de "ce qui devait rester secret, dans l'ombre et qui en est sorti" se présente, alors, sous un angle nouveau. Transposée dans le domaine linguistique, l'ambivalence du heimlich que pointe Freud entraîne double conséquence : d'une part, le parler familier instaure une connivence entre les locuteurs, connivence bâtie sur les restes d'un état originaire commun ; de l'autre, la collectivité soumet ce parler à des restrictions parce qu'il laisse échapper ce qui devrait demeurer caché pour le bon fonctionnement des règles sociales.
Pouvons-nous, ailleurs qu'en langue, relever des marques plus visibles du travail de la censure et cerner de plus près la fonction qui est la sienne ?
[i]D. François-Geiger,L'argoterie, recueil d'articles publié par le Centre d'Argotologie de l'UER de Linguistique, Paris V, Sorbonnargot, 1989, 177 pages.
[ii]J. Schön, "A propos de l'emploi "familier" de verbes courants en français", Cahiers du Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage, Université de Toulouse-le Mirail, vol. 11, 1995-1996, p.91-99.
[iii]Edition de 1973.
[iv]François Caradec, Dictionnaire du français argotique et populaire, Larousse, 1977.
[v]Pierre Guiraud, Le Français populaire, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", n° 1172, 1965, p.6.
[vi]J. Schön, "Dialogisme, politesse et culture : parler devant- et parler de-", Beiträge zur Dialogforschung, Dialoganalyse III, T. 1, Tübingen, Niemeyer, 1991, pp. 239-244.
[vii]S. Freud, L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, repris in collection Folio essais 1988, p.209-263.
[viii]Pour cette partie, cf. Georges Kleiber, Problèmes de référence : Descriptions définies et noms propres", Recherches Linguistiques, Centre d'Analyse Syntaxique, Univ. de Metz, vol. VI, 1981 et aussi E. Benveniste, "La phrase nominale" Bull. Société de Ling. de Paris, XLVI, 1950, repris in Problèmes de Linguistique Générale, Paris, Gallimard, NRF, 1966, p. 151-167.
[ix]J'éviterai, cependant, d'utiliser l'opposition dénotation/connotation qui nous entraînerait ailleurs.
[x]Cf. article cité note 2.
[xi] Acception absente dans mon Petit Robert mais consignée dans le dictionnaire du français argotique et populaire.
[xii] "Interprétation de formes pronominales en français et interprétation des rêves : une mise en parallèle", Hommages à Jeanine Fribourg, Meridies, revue d'anthropologie et de sociologie rurale de l'Europe du sud , Monte Real, Portugal, n° I9/20, 1994.
[xiii]J. Lacan, "Si la parole se fonde dans l'existence de l'Autre, le vrai, le langage est fait pour nous renvoyer à l'autre objectivé, à l'autre dont nous pouvons faire tout ce que nous voulons, y compris penser qu'il est un objet..." Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Le Séminaire, livre II, 1954-1955, Paris, Seuil, 1978, p. 286.
[xiv]Qui ne figure encore pas dans mon édition de dictionnaire dans son emploi familier.
[xv]J. Schön, "De l'infléchissement sémantique des verbes en emploi pronominal", La Linguistique, vol. 32, fasc.1,Paris, PUF, 1996, p. 103-117.
[xvi]Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir,"Lorsque moi j'emploie un mot répliqua Heumpty Deumpty d'un ton de voix quelque peu dédaigneux, il signifie exactement ce qu'il me plaît qu'il signifie...ni plus, ni moins."Paris, Flammarion, 1969, p. 108.
[xvii]J. Schön, "Figement et régression", La locution : entre lexique, syntaxe et pragmatique, Paris, Klincksieck, publication de l'INaLF, collection Saint-Cloud, à paraître.
commenter cet article …